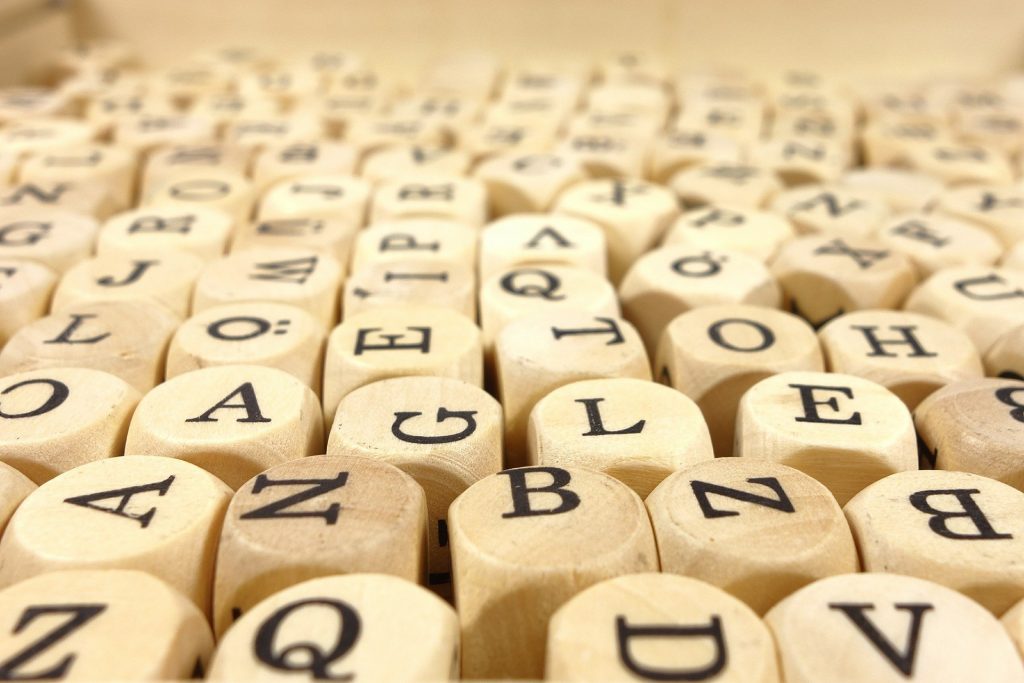
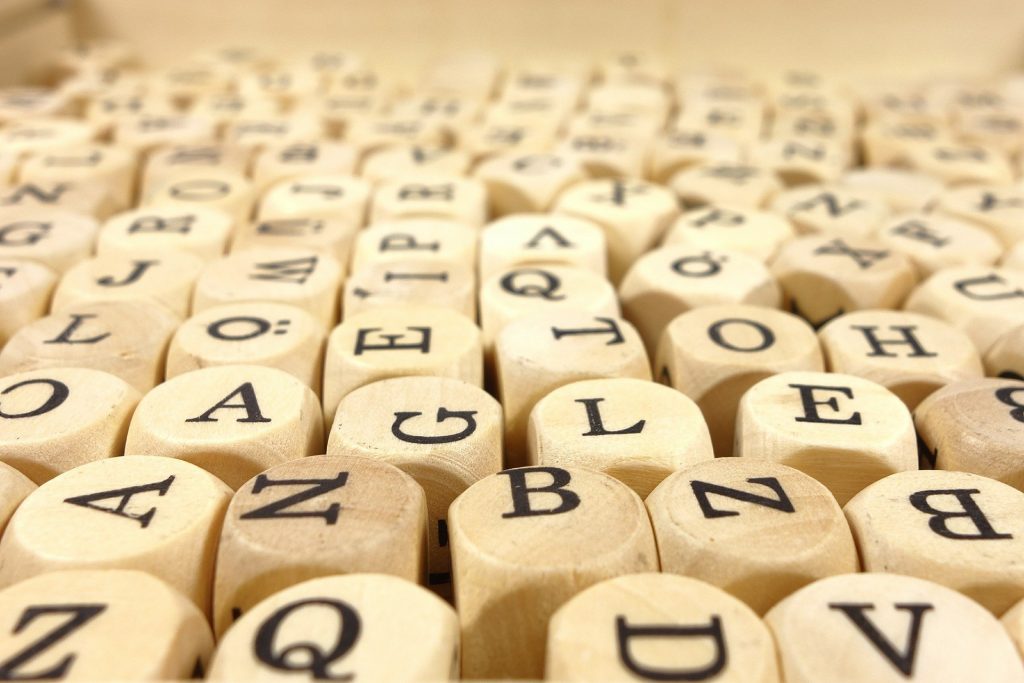
De 6 à 8 % de la population serait dyslexique. Jugée héréditaire, la dyslexie n’est pas une maladie mais un problème de « différence » dans l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe.
D’où vient la dyslexie ? Des dysfonctionnements dans le cerveau en seraient à l’origine, notamment au niveau du corps calleux, qui relie le côté gauche du cerveau au côté droit. Cette connexion permet aux informations de passer entre les deux moitiés du cerveau. Or une étude menée en 2002 par K. Von Plessen de l’hôpital universitaire de Bergen, en Norvège, a révélé une forme plus courte de corps calleux dans un groupe dyslexique.
Et si la dyslexie peut être décrite comme un trouble de l’apprentissage – et non pas une maladie –, c’est que ces dysfonctionnements entraînent des différences subtiles dans la façon dont le cerveau perçoit le mot écrit. Ces différences rendent l’apprentissage de la lecture et l’écriture difficiles, et peuvent aussi affecter la façon dont nous gérons les chiffres.
La dyslexie trouble également la mémoire de travail, une mémoire à court terme permettant de stocker et de manipuler temporairement des informations afin de réaliser une tâche particulière, comme un raisonnement ou un calcul. Des difficultés d’organisation, de séquencement et de motricité peuvent également être présentes.
Des difficultés dans la vie quotidienne
La manière dont la dyslexie a un impact sur la vie quotidienne a tendance à changer au fil des années. À l’école primaire, l’accent est mis sur l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et de l’orthographe. Les principales difficultés rencontrées consisteront alors à faire correspondre les sons des mots avec les lettres et à se rappeler de la direction des lettres. Souvent des difficultés de coordination motrice, de mémoire et d’attention sont aussi présentes. Et au lycée, l’élève doit lire pour apprendre. Le défi consistera donc pour l’élève à pouvoir traiter une vaste gamme de sujets, le volume de lecture et d’écriture requis et à se préparer pour des examens.
Dans la vie adulte, la lecture et l’écriture posent encore des difficultés, la planification, l’organisation, la mémoire et parfois la maladresse peuvent aussi rester problématiques. Un traitement plus lent des informations auditives et visuelles, des difficultés de mémoire de travail, des difficultés phonologiques et une mauvaise orthographe sont des aspects de la dyslexie qui sont constants et qui ne disparaissent pas lorsque l’on quitte l’école.
Des difficultés à gérer son temps et à organiser ses tâches sont des aspects du travail et de la vie familiale qui nécessitent une attention constante. Pour les dyslexiques, grandir et évoluer dans un monde qui exige qu’ils s’engagent chaque jour dans des tâches qui s’avèrent pour eux très difficiles peut provoquer de la colère et de la frustration, ou détériorer la confiance en soi, compliquer les relations professionnelles ou familiales.
C’est par exemple ce que décrit Henry Winkler, dyslexique et acteur américain reconnu. Il avouait récemment à la radio américaine NPR s’être longtemps senti « stupide » à cause de ses difficultés et avoir dû recourir à des subterfuges lorsqu’il passait des auditions et devait lire un script.
Einstein était dyslexique
Mais la technologie peut être d’une grande aide : l’utilisation d’un correcteur orthographique dans les programmes de traitement de texte peut permettre aux gens d’écrire sans inquiétude. L’utilisation du téléphone mobile pour stocker des informations et des rappels peut éviter de se perdre et d’oublier des informations importantes.
Par ailleurs, il est de plus en plus documenté que les personnes dyslexiques peuvent être plus avancées et créatives dans la façon dont ils voient, comprennent et traitent des informations non verbales ou résolvent des problèmes. Dans leur livre The dyslexic advantage [non traduit en français, ndlr], les docteurs Brock et Fernette Eide décrivent quatre capacités associées à la dyslexie.
Les dyslexiques sont plus à l’aise avec le raisonnement matériel ou spatial, le raisonnement interconnecté (capacité à voir les liens et les relations) ou le raisonnement narratif (capacité à voir les faits comme des histoires ou des exemples, plutôt que comme des informations abstraites). Ces atouts peuvent aider les dyslexiques dans les domaines de l’architecture, du design, de la médecine chirurgicale, de l’art visuel et des sciences. N’oublions pas qu’Albert Einstein et Léonard De Vinci étaient sévèrement dyslexiques.
Pour en savoir plus : Étude K. Von Plessen, Less developed corpus callosum in dyslexic subjects, 2002
Dyslexia made Henry Winkler feel stupid for years. Now he’s a best selling author, article du 27/01/2019, www.npr.org
1 Eide & F. Eide, The dyslexic advantage, Hay House, 2011
Elisabeth Brookes

Article issu du TVB 36
Retour vers la catégorie : Société
